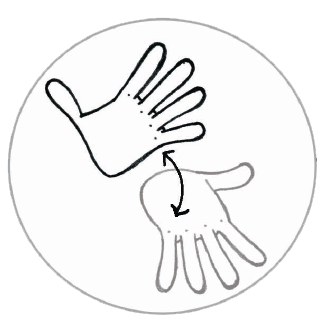Selon Seleskovitch (1982), la traduction comporte trois niveaux : le niveau de la signification des formes linguistiques (mots, phrases), identifiables hors contexte ; le niveau du sens que la signification véhicule dans une situation concrète ; et le niveau de restitution du sens dans la langue d’arrivée. Srpová (1995) qualifie le passage de la première à la deuxième étape comme celui de la compréhension – perspective sémasiologique, et le passage de la deuxième à la troisième étape comme celui de l’expression – perspective onomasiologique. D. Seleskovitch a été une des premières à souligner le fait que la traduction n’est pas un processus direct de langue à langue, mais passe par une étape cognitive de saisie du sens avant sa reformulation dans une autre langue. Et le travail quotidien des interprètes leur montre la pertinence de cette analyse.
Delisle (1980) décrit également trois niveaux de traduction, en un autre sens que Seleskovitch. Il distingue l’interprétation des chiffres, termes techniques, noms propres – termes monosémiques ne nécessitant pas d’interprétation à proprement parler (interprétation de ‘niveau zéro’) ; et l’interprétation des termes polysémiques – dont certains tiennent leur sens directement du contexte et peuvent trouver un équivalent dans la langue d’arrivée selon un processus de simple transposition (interprétation de ‘premier niveau’), et dont d’autres nécessitent une adaptation particulière, une recréation originale dans la langue d’arrivée (jeux de langue, images inédites, jeux de mots…) – interprétation de ‘second niveau’. Là encore, un interprète en langue des signes – par exemple – sait que certains termes ne relèvent pas de l’ordre de l’interprétation, mais d’une simple ‘transduction’ ; que d’autres termes ou expressions sont facilement traduisibles – lorsque leur sens est clairement indiqué par le contexte ; et qu’enfin certains termes ou expressions d’une langue n’ont pas d’équivalent dans l’autre langue, et nécessitent une adaptation particulière. Vinay et Darbelnet (1958) donnent un certain nombre d’exemples de ces adaptations entre le français et l’anglais : fr. en un clin d’œil – angl. before you could say Jack Robinson ; fr. Bon appétit – U.S.Hi ; fr. comme un chien dans un jeu de quilles – angl. like a bull in a china shops ; fr.château de cartes – angl. Hollow Triumph…
Toutefois, certaines de ces adaptations dépassent la simple équivalence entre termes ou expressions, et manifestent des différences d’ordre culturel : par exemple, traduire directement « he kissed his daughter on the mouth » par « il embrassa sa fille sur la bouche » n’est pas une bonne traduction, car un tel élan affectif est ‘naturel’ dans certains pays, alors qu’il paraîtrait incongru, indécent, voire condamnable dans d’autres pays. Vinay et Darbelnet (1958 : 52) conseillent de traduire cette phrase par : « il serra tendrement sa fille dans ses bras ».
Srpová (1995) critique donc le mouvement ternaire développé par Seleskovitch. A son avis, ce découpage correspond à la traduction entre deux langues qui ont les mêmes références extralinguistiques, mais n’est pas adapté lorsque des différences extralinguistiques se font jour – ce qui est le cas entre la plupart des langues. Il opte donc pour une traduction en quatre temps :
![]() identifier dans le texte de départ les formes et les significations linguistiques de la langue de départ
identifier dans le texte de départ les formes et les significations linguistiques de la langue de départ
![]() comprendre le sens du texte original en fonction de la culture de départ
comprendre le sens du texte original en fonction de la culture de départ
![]() situer, réinterpréter le sens compris dans la deuxième étape dans la culture d’arrivée
situer, réinterpréter le sens compris dans la deuxième étape dans la culture d’arrivée
![]() l’exprimer dans le texte de la langue d’arrivée (1995 : 167-168)
l’exprimer dans le texte de la langue d’arrivée (1995 : 167-168)
Ce travail en quatre temps peut correspondre, effectivement, à la situation des interprètes en langue des signes. Il arrive, bien que les sourds français partagent le même espace culturel que les entendants qu’ils rencontrent, que l’interprète doive trouver des équivalences culturelles dans ses traductions. Et l’iconicité en est un bon exemple. L’appréhension des sourds étant visuelle, un certain nombre de références seront d’ordre purement visuel, là où une bonne traduction doit trouver un équivalent pour une culture d’entendant – et inversement. Par exemple, la référence à une personne ou à un lieu sera construite sur des traits purement visuels en langue des signes (en dehors même des noms propres), alors que d’autres références, d’autres critères seront plus adaptés à un public entendant.
Srpová (1991 et 1992) aboutit ainsi à une typologie des traductions écrites :
![]() les traductions littérales : les spécificités référentielles sont conservées telles quelles dans la langue d’arrivée (emprunt, calque lexical…). Ces traductions peuvent être accompagnées, dans le texte ou en notes, d’explication. Par exemple, le « doctorat d’État » français pourra être accompagné d’une note expliquant la valeur de ce diplôme par rapport aux diplômes de la culture d’arrivée.
les traductions littérales : les spécificités référentielles sont conservées telles quelles dans la langue d’arrivée (emprunt, calque lexical…). Ces traductions peuvent être accompagnées, dans le texte ou en notes, d’explication. Par exemple, le « doctorat d’État » français pourra être accompagné d’une note expliquant la valeur de ce diplôme par rapport aux diplômes de la culture d’arrivée.
![]() les traductions généralisantes : les spécificités référentielles sont ‘neutralisées’ ; elles sont remplacées, dans la traduction, par la référence à une classe plus générale, permettant de comprendre la classe à laquelle appartient le terme d’origine. Il peut s’agir, par exemple, de la classe d’un objet, d’une démarche, d’un comportement…
les traductions généralisantes : les spécificités référentielles sont ‘neutralisées’ ; elles sont remplacées, dans la traduction, par la référence à une classe plus générale, permettant de comprendre la classe à laquelle appartient le terme d’origine. Il peut s’agir, par exemple, de la classe d’un objet, d’une démarche, d’un comportement…
![]() les traductions adaptatives : la spécificité référentielle de la langue de départ est remplacée par une spécificité référentielle analogue de la langue d’arrivée. Par exemple, tel comportement de la culture de départ est remplacé par un comportement analogue de la culture d’arrivée.
les traductions adaptatives : la spécificité référentielle de la langue de départ est remplacée par une spécificité référentielle analogue de la langue d’arrivée. Par exemple, tel comportement de la culture de départ est remplacé par un comportement analogue de la culture d’arrivée.
Srpová (1991 : 68-69) note que le choix entre ces types de traduction dépend du genre du texte à traduire et notamment de la primauté informative du passage en question. Pour un interprète en langue des signes, des situations différentes peuvent nécessiter le recours à des types de traductions divers. En situation de traduction scolaire, universitaire ou de formation professionnelle, on nous demande souvent des traductions plus littérales, car les sourds en formation ont généralement besoin de connaître les termes, expressions, références précises utilisées par le professeur. Au contraire, dans la plupart des autres situations, il est préférable d’utiliser les traductions adaptatives. A notre avis, les traductions généralisantes sont un dernier recours, lorsqu’une traduction adaptative n’est pas possible ou n’est pas trouvée dans l’instant par l’interprète en situation. Cependant, réussir de bonnes interprétations adaptatives en situation de traduction simultanée nécessite une certaine maîtrise – ou une maîtrise certaine – des techniques d’interprétariat. Cela est difficile pour des interprètes débutants.
D’un autre point de vue, Meschonnic (1973, 1999) remarque que l’élaboration d’un texte relève de l’ordre de la traduction : les différentes variantes d’un texte, avant d’arriver à la production finale, montrent les processus de productivité textuelle comme des phases successives d’une traduction interne. Robel en vient ainsi à conclure : « Un texte ne peut exister sans traduction […] un texte qui ne peut être traduit n’a aucun sens […] c’est la traduction qui dit le sens du texte. » (1973). Ceci va à l’encontre de l’idée répandue du texte comme œuvre unique. Et remet en question les limites supposées de la traduction, par exemple entre énoncés en français et en langue des signes. En effet, même si les modalités d’expression sont différentes, même si les processus cognitifs ne sont pas tout à fait identiques, même si les images utilisées sont sensiblement diverses, le travail même de l’interprète montre que le sens est toujours traduisible (si l’interprète l’a compris), et que les impossibilités de traduction ne portent généralement que sur des questions ‘de surface’, comme des jeux de mots ou expressions figées. Cela remet également l’iconicité de la langue à sa place : comme outil de production de sens, ou plus précisément, matériau pour l’élaboration d’outils pour la production du sens – l’important, pour un interprète, étant le sens. Dans ce cadre, les recherches sur l’iconicité peuvent aider l’interprète à mieux appréhender l’iconicité utilisée par la langue – et donc à pouvoir trouver des traductions plus précises, fidèles, et rapides. Mais l’iconicité n’a pas à être érigée en barrière, en obstacle à la production du sens – au contraire.
D’ailleurs, la traduction de signes iconiques peut varier en fonction de la situation de traduction, des effets de sens recherchés, de la volonté sémiotique du locuteur. Comme le souligne Asprer : « Certaines formes iconiques, fonctionnant à la manière du collage, comportant des signes pour ainsi dire universaux, se passent de traduction. Mais ceci est encore une option de traduction, et ne nous permet pas pour autant d’en faire une prémisse du type ‘on ne traduit pas les icones directs’. Pas de grille possible, pas de manuel, pas de solutions définitives pour chaque catégorie d’iconicité : pas de catégories étanches. » (2002 : 150) Cette remarque portant sur la traduction littéraire est également valable pour les traductions langue des signes/français.
Mais si l’iconicité n’a pas à être érigée en barrière, elle n’a pas non plus à être négligée : « L’iconicité n’est donc pas un phénomène rare, de l’ordre de l’exception. Nous avons vu que tout est susceptible de faire icône, car le critère de la ressemblance est considéré dans une perspective dynamique. […] Une prise en compte de l’iconicité permettrait d’éviter ‘l’appauvrissement qualitatif’ dont parle aussi Berman dans son approche de l’analytique de la traduction et de la systématique de la déformation, lorsqu’il soutient que ‘prose et poésie – chacune à leur manière – produisent ce qu’on peut appeler des surfaces d’iconicité’ (1999 : 59) » (Asprer, 2002 : 326) C’est ainsi que la prise en compte de l’iconicité pour un interprète en langue des signes est très importante : elle évite une platitude, une sécheresse, une pauvreté de la traduction, qui ne fait pas ressortir la finesse, les subtilités visuelles mises en œuvre dans les énoncés originels. D’ailleurs, K. Davis s’oppose la conception de la traduction comme simple transfert de sens, reproduction passive : le sens est instable, il n’est pas un donné mais s’inscrit dans une sémiose (2001). C’est pourquoi, selon Asprer (2002), la traduction nécessite une ‘liberté’ du traducteur, tenant compte non seulement du texte, de l’analyse du discours, des éléments de linguistique et rhétorique appelés par le texte, mais également de tous les éléments qui l’environnent (sémiotique, sociologie, psychanalyse, etc.) – et l’on peut rajouter, pour les interprètes en langue des signes, la prise en compte de toutes les formes d’expression visuelles, notamment toutes les formes culturalisées qui peuvent avoir influencé directement ou indirectement, consciemment ou non, la formation d’expressions signées. C’est tout cet environnement – acquis progressivement par l’interprète au cours de son expérience professionnelle – qui permet de produire non pas une traduction littérale, mais une traduction riche du vouloir dire énonciatif – avec toutes les difficultés et tous les dangers de la traduction, à commencer par la compréhension de ce vouloir dire et le ressenti personnel de l’interprète : « Pas plus qu’un texte, une traduction n’est jamais achevée » (2002 : 332)
Traduire n° 221 : Voies de l’interprétation
125 pages, 23 €
Présentation de l’éditeur :
Saviez-vous que les institutions européennes craignent de connaître dans les prochaines années une pénurie d’interprètes, notamment en langue française ? Au point que la DG Interprétation de la Commission a récemment lancé une grande campagne de sensibilisation, n’hésitant pas à ouvrir un canal sur Daily Motion et You Tube pour inciter les éventuels postulants à « découvrir une carrière prestigieuse au cœur de la politique européenne » et que M. Marco Benedetti, directeur général de la DG Interprétation lance personnellement le message suivant : « Apprenez les langues, il y a des perspectives de métiers intéressants et bien rémunérés au bout ». Mais qui sont-ils, qu’est-ce qui fait la différence entre traducteurs et interprètes ? Dans ce numéro de Traduire, vous ferez connaissance avec les doux vocables de chuchotage, concabin, mode simultané ou consécutif et vous découvrirez différentes facettes de ce métier peu commun au travers d’articles et d’interviews.
Et pour compléter le cahier « interprétation », Traduire propose aussi d’autres articles et comptes rendus d’ouvrages autour de la traduction.
Sommaire :
Cahier interprétation
Traduction et interprétation, deux volets d’un même métier ou deux métiers différents ? Christine Cross
Les interprètes sont-ils des tricheurs ? Benoît Kremer
Les différents types d’inférence dans la compréhension orale du japonais, Franck Tiret
Interprètes en langue des signes : autour de l’intervention de M.-T. L’Huillier à la JMT 2008, Françoise Wirth
Entretien avec Gilles Ouvrard, interprète de conférence, Freddie Plassard
Entretien avec Massoumeh Lahidji, interprète pour le cinéma, Vanessa De Pizzol
Pratiques et perceptions de la révision en France, Katell Hernández Morin
Le traducteur juridique face à la différence, Malcolm Harvey
Les traductions du latin en italien des XVe – XVIe siècles, Moreno Campetella
Le Prix Pierre-François Caillé de la Traduction, Florence Herbulot
Comptes rendus d’ouvrage
Blues et gospels, Traduction de Marguerite Yourcenar, Christian Casoni
Traduire le genre : femmes en traduction, Palimpsestes n° 22, Pascale Sardin (dir.), Freddie Plassard
Le sot de l’ange, Christopher Moore (traduction de Luc Baranger), Claudie Pons
Rétrospective n° 15, Maurice Voituriez
Responsable : SFT
Url de référence : http://www.sft.fr/fo/prive/produits…